
 |
|
Urgence et signalement
1 800 463-9009 |
ServicesServices de protection de la jeunesseTélécharchez le document «On a signalé la situation de votre enfant au DPJ» © Gouvernement du Québec, 2007 Les services de la protection de la jeunesse se divisent en étapes, soit : Le signalement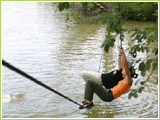 C'est par un signalement que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est alerté de la situation d'un enfant. Très majoritairement, ce sont des appels téléphoniques reçus du milieu familial, des employés de différents organismes, du milieu scolaire, du milieu policier ou de citoyens. De façon rare, un signalement peut être fait par écrit ou par des personnes qui se présentent directement dans un bureau du DPJ. La réception et le traitement du signalementC'est une activité clinique qui consiste à recevoir un signalement, à l'analyser à partir des informations obtenues et, au besoin, en effectuant des vérifications auprès d'une garderie, d'une école, d'un centre de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme. Il peut aussi arriver que le DPJ effectue des vérifications à l'endroit où se trouve l'enfant. C'est à cette étape qu'il va décider de retenir ou non un signalement. Les mesures de protection immédiateAprès avoir retenu un signalement, le DPJ peut être dans l'obligation de prendre des mesures pour assurer la protection immédiate d'un enfant. Des mesures de protection immédiate peuvent être prises à toute heure du jour. Elles consistent essentiellement à retirer l'enfant du milieu où il se trouve et à le placer dans un endroit sécuritaire, soit chez d'autres membres de la famille, dans une famille d'accueil ou dans une unité de vie. L'évaluationLorsqu'un signalement est retenu, le DPJ doit procéder à l'évaluation de la situation d'un enfant. Il rencontre l'enfant, ses parents et toutes les personnes susceptibles de l'éclairer pour déterminer si l'enfant a besoin de protection. L'analyse des informations obtenues permet au DPJ de décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est ou n'est pas compromis. Dans environ 50% des évaluations, le DPJ considèrera que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas compromis. C'est une étape d'intervention importante qui entraînera le maintien ou non de la présence de l'État dans la vie des familles. L'orientation : le choix des mesures de protectionLorsque le DPJ décide que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, il poursuit son intervention. L'orientation est une activité clinique qui consiste à évaluer la motivation et la capacité de l'enfant et des parents à corriger la situation problématique et à obtenir, si possible, leur accord sur les mesures qui pourraient être prises. Elle permet de décider si les services en protection de la jeunesse seront donnés sur une base volontaire ou s'il faudra recourir au tribunal.
L'application des mesuresLe DPJ est responsable d'assurer le suivi des mesures volontaires ou ordonnées. L'application des mesures est une activité clinique qui consiste à apporter de l'aide à l'enfant et à ses parents, mais aussi à exercer une surveillance, pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement d'un enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. La révisionLe DPJ a l'obligation de réviser périodiquement la situation d'un enfant suivi en protection de la jeunesse. La révision est une activité clinique qui consiste à vérifier les mesures prises, à évaluer les résultats obtenus et à décider si elles doivent être modifiées, poursuivies ou prendre fin. C'est une activité qui est généralement effectuée par des professionnels qui ne sont pas impliqués dans le suivi des enfants et des parents. La fin de l'interventionLorsque le DPJ convient avec l’enfant et ses parents que la sécurité ou le développement n’est plus compromis, il doit mettre fin à son intervention. L’intervention doit aussi prendre fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Si l’enfant ou ses parents ont encore besoin d’aide, le DPJ doit les informer des ressources disponibles dans la communauté et il doit, s’ils le consentent, les diriger vers ces ressources. |
|